
 |
La troisième génération
La troisième génération de biocarburant se distingue de la deuxième et de la première par la biomasse utilisée. La biomasse utilisée par la troisième génération de biocarburant est l'algue. Elle est principalement utilisée dans la production d'hydrogène et d'huile. |
|
L'hydrogèneProduction
|
|
Utilisation
|
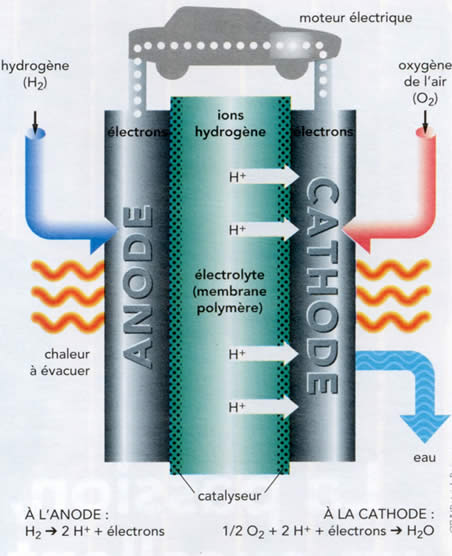 |
Bilan
|
|
Les algues
La diversité des micro-algues est très peu exploitée. Sur un million d’espèces estimées, environ 30 000 ont été étudié. Cependant, on utilise déjà ces algues dans l'alimentaire, les cosmétiques, les fertilisants et bientôt dans nos biocarburants grâce à leur potentiel énergétique trouvé dans leur production d'amidon (source de bioéthanol), mais surtout, dans leur production de lipides (source de biodiesel). |
 |
Culture des alguesLa culture des macro-algues est aujourd'hui impossible. Ceci est dû à l'impossibilité de cultiver dans des conditions offshore. La culture offshore présente aujourd'hui des problèmes scientifiques, technologiques et économiques. Il faut dans un premier temps développer nos connaissances sur les macro-algues, plus particulièrement sur leur physiologie, mais aussi sur des technologies de cultures offshore. Il existe trois modes de culture pour les micro-algues : > Les Bassins ouvertsLe système de production d'algues le plus classique et le plus ancien est celui du bassin à ciel ouvert. Il consiste à reproduire les conditions naturelles de développement des algues dans un bassin. Le modèle de bassin le plus courant et ayant la meilleure productivité est le bassin de type « raceway ». C'est un bassin profond de quelques dizaines de centimètres, agencé en une longue boucle. Il est brassé mécaniquement pour assurer une homogénéité de la culture. Ces bassins sont branchés en deux endroits, assurant ainsi une arrivée de culture fraîche et un prélèvement de la récolte. Les éléments nutritifs sont aussi apportés pour une croissance optimale des algues. Le CO2 nécessaire au développement des algues est apporté par bullage, bien que son transfert dans la phase liquide soit souvent mauvais, dû à la profondeur des bassins. |
 |
> Les PhotobioréacteursLe photobioréacteur est un système clos où se déroule une réaction biochimique de photosynthèse ayant pour but de produire de la biomasse végétale. Le photobioréacteur est conçu pour contrôler cette réaction en influant sur plusieurs facteurs comme l'exposition à la lumière ou l'apport en gaz carbonique. Mais l'influence sur ces facteurs a surtout pour but de garder une production constante de biomasse micro-algale. La principale difficulté est de garder une homogénéité du milieu ; en particulier, dans l'apport en lumière au niveau de chaque cellule, car l'intensité lumineuse diminue rapidement dès que l'on s'éloigne de la périphérie du réacteur. Ce problème aboutit à la non croissance des micro-algues se trouvant au centre du réacteur. Les chercheurs ont donc établit des systèmes ayant un rapport surface/volume élevé. Le photobioréacteur tubulaire est un exemple (ci-joint) avec ses cultures de micro-algues circulants dans des tubes de faible épaisseur. Les réacteurs peuvent être solaires ou artificiel. Le seul inconvénient du solaire est sa variabilité d'intensité en fonction de l'heure de la journée et de la saison. Le système mixte Il est possible de combiner les deux systèmes précédents en produisant des micro-algues dans le photobioréacteur pour ensuite les déverser dans un bassin où la culture est réalisée. Cet hybridation des deux techniques permet de maximiser les points forts tout en palliant à leurs faiblesses. |
 |
> La culture hétérotropheLa culture hétérotrophe se base, quant à elle, non pas sur la lumière, mais sur un substrat carboné de type sucre (par exemple : déchets et sous-produits de sucreries). Cela rapproche cette culture de la fermentation par son utilisation de bioréacteurs fermés, semblables à des fermenteurs. Cette méthode a aussi l'avantage de ne pas avoir à utiliser de micro-algues particulières. Elle a de hauts niveaux de productivités. Bien que la culture en bassin ouvert soit aujourd'hui la plus répandue, elle reste néanmoins difficile à mettre en place sans aucun problème lié au milieu. Le photobioréacteur, quant à lui, consomme plus d'énergie mais il est plus rentable d'une certaine manière. Il y a moins de nutriments utilisés, moins d'eau (pas d'évaporation) et surtout il n'y a pas de contamination par d'autres espèces moins productives en huile. La culture hétérotrophe semble, quant à elle, être plus productive bien qu'elle ne soit encore qu'au stade d’expérimentation. TransformationLes micro-algues doivent subir une transformation avant de pouvoir être utilisable, ou plutôt, avant que leur huile soit utilisable. Cette transformation se fait par pyrolyse, gazéification ou par extraction d'huile. Les rendements observés utilisables pour la production de biodiesel se situent entre 20 et 50% du poids sec des algues. Il existe chez certaines espèces, avec des conditions de culture particulières, des rendements de 90%. Ces rendements sont cependant associés à un faible taux de croissance algale. Il est possible de calculer la productivité moyenne d'un hectare en prenant la production moyenne de biomasse d'algue par jour qui est de 20g/m²/jour à 20% d'huile(poids sec). On obtient une productivité de 20000 l d'huile/ha/an, ce qui donne environ 4 fois les meilleurs rendements des meilleures cultures de première génération utilisé es pour la production de biocarburant. Bilan
|
|